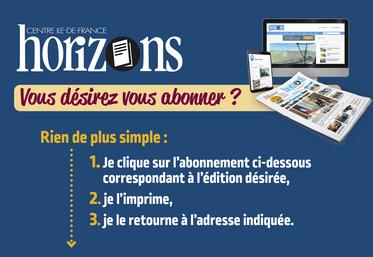Interview de Matthieu Mardelet
« L'irrigation eurélienne repose sur une approche raisonnée »
Agriculteur irrigant à Moutiers-en-Beauce, Matthieu Mardelet est élu à la chambre d’Agriculture d'Eure-et-Loir sur les questions de l’eau, des sols et du climat et préside l'Organisme unique de gestion collective (OUGC) des irrigants d'Eure-et-Loir. Nous l’avons interrogé sur l’irrigation dans notre département et sur sa vision de son évolution.
Agriculteur irrigant à Moutiers-en-Beauce, Matthieu Mardelet est élu à la chambre d’Agriculture d'Eure-et-Loir sur les questions de l’eau, des sols et du climat et préside l'Organisme unique de gestion collective (OUGC) des irrigants d'Eure-et-Loir. Nous l’avons interrogé sur l’irrigation dans notre département et sur sa vision de son évolution.

Quelle est l'importance et la plus-value de l'irrigation en Eure-et-Loir ?
Mathieu Mardelet : L'irrigation constitue un pilier stratégique pour l'agriculture eurélienne, avec près d'un millier d'irrigants répartis sur l'ensemble du département, majoritairement dans sa partie sud. Ces exploitants puisent dans plusieurs ressources distinctes : la nappe de Beauce au sud-est, la nappe de craie au centre et au nord, le cénomanien à l'ouest, complétées par des prélèvements en rivière pour une minorité d'entre eux.
Cette pratique, bien ancrée dans notre territoire, a d'abord permis de sécuriser les rendements des cultures traditionnelles avant de devenir un véritable levier de diversification. Elle a notamment facilité l'implantation de légumes de plein champ, de cultures industrielles et de porte-graines, représentant ainsi un double enjeu : garantir la stabilité de notre production agricole tout en dynamisant l'innovation culturale sur notre territoire.
Comment l'irrigation est-elle gérée sur notre territoire ?
La majorité des prélèvements s'effectue dans les nappes phréatiques, avec deux zones distinctes aux caractéristiques propres. Dans la nappe de Beauce, où l'irrigation est historiquement plus développée, nous avons mis en place depuis longtemps une gestion rigoureuse et contrôlée des prélèvements, actuellement portée par un Organisme unique de gestion collective (OUGC), qui a notamment pour rôle de répartir la ressource en eau entre l’ensemble des irrigants.
Le fonctionnement de cette nappe est parfaitement documenté : comparable à une réserve souterraine, elle se recharge naturellement par les précipitations hivernales et permet des prélèvements durant les périodes printanières et estivales. Ce cycle régulier de recharge en fait une ressource renouvelable, à condition de maîtriser strictement les volumes prélevés.
Pour la nappe de Craie, où l'irrigation connaît un développement croissant, des études approfondies sont actuellement menées par le département afin de déterminer avec précision son fonctionnement hydrogéologique et d'établir les volumes prélevables optimaux.
Lire aussi Les irrigants d'Eure-et-Loir auront l'eau des nappes pour la campagne
Comment voyez-vous l'avenir de l'irrigation ?
L'avenir de l'irrigation repose sur une approche intégrée et responsable. Nous devons impérativement quantifier nos prélèvements et reconnaître que l'agriculture s'inscrit dans un écosystème plus large d'utilisateurs de cette ressource vitale, partagée avec l'industrie et l'alimentation en eau potable des populations.
Si l'enjeu quantitatif demeure essentiel, la dimension qualitative exige une vigilance tout aussi importante. Nos pratiques agricoles doivent atteindre l'excellence en matière de gestion des nitrates et des produits phytosanitaires pour préserver durablement la qualité de cette ressource indispensable à tous. C'est à cette condition que nous pourrons garantir un avenir durable à l'irrigation dans notre département.
L'évolution de l'irrigation s'inscrit dans une démarche d'excellence technique et environnementale. Il est important de souligner que chaque prélèvement est mesuré et déclaré aux autorités administratives, garantissant une transparence totale de nos pratiques. L'irrigation eurélienne repose sur une approche raisonnée qui intègre systématiquement les besoins spécifiques des cultures et les données climatiques locales pour déterminer précisément le moment et le volume des apports en eau.
Les agriculteurs disposent désormais d'outils d'aide à la décision performants, tels que Net-Irrig ou l’Irricarte, qui leur fournissent un conseil personnalisé et géolocalisé. Ces technologies de pointe nous permettent d'optimiser significativement nos applications d'eau, réalisant ainsi des économies substantielles tout en préservant le potentiel productif de nos cultures.
Face aux défis croissants de la raréfaction des ressources hydriques et du dérèglement climatique, l'expertise territoriale des agriculteurs et leur approche rigoureuse constituent un atout majeur. Les dispositifs de suivi mis en place et les mesures régulières effectuées démontrent qu'une gestion durable de l'irrigation est non seulement possible mais déjà opérationnelle dans notre département.