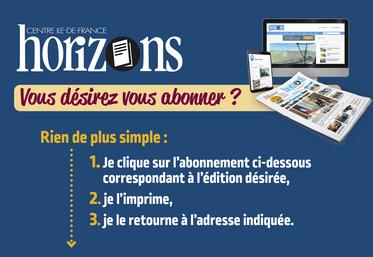Irrigants du Fusain : le coefficient 1, enfin
Les irrigants du Fusain bénéficient d’un coefficient 1 pour la campagne d’irrigation 2025. Une bonne nouvelle pour ce secteur dont les coefficients se situaient les campagnes précédentes entre 0,5 et 0,7 au regard des indicateurs qui servent de référence. Les représentants des irrigants du secteur estiment que ces seuils ne sont pas en adéquation avec la réalité.
Les irrigants du Fusain bénéficient d’un coefficient 1 pour la campagne d’irrigation 2025. Une bonne nouvelle pour ce secteur dont les coefficients se situaient les campagnes précédentes entre 0,5 et 0,7 au regard des indicateurs qui servent de référence. Les représentants des irrigants du secteur estiment que ces seuils ne sont pas en adéquation avec la réalité.

Il aura fallu plusieurs centaines de millimètres de précipitations en excédent ces dix-huit derniers mois pour que les nappes remontent significativement et dépassent enfin le seuil piézométrique d’alerte. En conséquence de cette situation exceptionnelle, les irrigants du secteur Fusain de la nappe de Beauce peuvent enfin bénéficier cette année d’un coefficient 1, une première depuis fort longtemps. C’est une bonne nouvelle pour Xavier Sureau, président du Syndicat de gestion des eaux et de l’environnement du Gâtinais ouest, le SGEEGO, confronté à des coefficients situés entre 0,5 et 0,7 depuis 2019. Car l’attribution des coefficients d’irrigation dans ce secteur suscite l’incompréhension depuis de nombreuses années.
La zone Fusain minorée
La nappe de Beauce est gérée en quatre secteurs d’irrigation : la Beauce centrale, la Beauce blésoise, le Montargois et le Fusain. Chaque année, sur chacun de ces secteurs, des coefficients sont attribués en fonction du niveau de référence de la nappe par rapport à des seuils, propres à chaque secteur de gestion. Ces coefficients viennent pondérer les volumes de référence attribués aux irrigants. Ils permettent de calculer les volumes prélevables par chacun pour la campagne d’irrigation à venir. Ainsi, les années précédentes, sur la zone Fusain, les 200 irrigants du secteur se sont vu attribuer des quotas d’irrigation minorés de 30 à 50 %.
Pourtant, l’évolution de la nappe montrait une recharge hivernale, comme sur les autres secteurs de la nappe de Beauce, qui se sont vu attribuer un coefficient de 1. Xavier Sureau porte les revendications des irrigants du secteur depuis de nombreuses années : « Soit les piézomètres de référence du Fusain ne sont pas en adéquation avec le secteur, soit les seuils de référence ont un niveau inatteignable, pointe-il. Les indicateurs utilisés pour la Beauce centrale et pour le secteur Fusain ont des périodes de référence différentes, alors qu’il n’y a pas de cloison entre la nappe centrale de Beauce et celle du secteur Fusain ». Le suivi piézométrique du Fusain commence en 1995 et ne prend pas en compte la référence basse de 1991 qui a pourtant servi à fixer le seuil de crise sur la nappe de Beauce. Autre constat : le seuil d’alerte du secteur Fusain a été fixé à un niveau très proche du niveau maximum de la nappe observé en 2001-2002 et il n’a pu être atteint que six fois en trente ans (hivers 2001, 2002, 2003, 2014, 2016 et 2018), dans des contextes pluviométriques souvent exceptionnels.
Une incompréhension pour les irrigants que représente Xavier Sureau : « La Dreal dit que l’attribution des irrigants du Fusain est trop importante. Le mode de calcul utilisé depuis 2011 ne permet de dépasser un coefficient de 0,7 que trop rarement ».
Pour tenter de répondre aux interrogations du monde agricole, une étude de la Commission locale de l’eau (Cle) du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) Nappe de Beauce a démarré fin 2018 pour une durée initiale de deux ans et demi. Le dernier comité de pilotage remonte au 10 octobre 2023, une réunion « désastreuse pour la profession agricole car totalement à charge contre l’irrigation. Un courrier co-signé de la profession a été adressé au porteur de l’étude afin de rappeler les objectifs initiaux et les différents scénarios qui devaient être travaillés par le cabinet d’étude », regrette le président. Une réponse a été adressée par le Sage de la nappe de Beauce en avril 2024, « indiquant que la profession s’alarmait pour pas grand-chose », selon Xavier Sureau, mais depuis, le comité de pilotage ne s’est pas réuni.
Une perte de compétitivité
Sur cette zone où l’on produit des betteraves, du maïs, des pommes de terre et des oignons sur des surfaces plus marginales, où l’irrigation des céréales au printemps est parfois nécessaire, les irrigants ont un réel sentiment d’incompréhension. D’autant qu’ils ne cherchent pas à irriguer davantage mais à maintenir leur capacité d’irrigation et à maintenir un potentiel de rendement, vite malmené par le stress hydrique. « Les irrigants de la zone de sentent stigmatisés et défavorisés compte tenu de la fourchette de coefficient qui leur est attribuée (0,5-0,7). Beaucoup d’efforts sont faits sur les assolements, mais c’est une perte de compétitivité pour les entreprises et les filières locales (peu de pommes de terre, d’oignons, cultures à valeur ajoutée). D’autant que le volume agricole prélevé est plutôt à la baisse », explique Xavier Sureau, qui conclut : « Quand la situation est clémente, sans attendre qu’elle soit exceptionnelle comme cette année, il faut que le coefficient remonte ! ».
Lire aussi Irrigation : le Loiret fait le plein