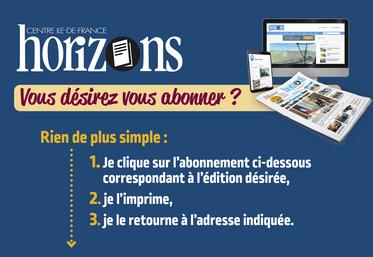Fédération des Cuma Île-de-France : une AG pour bien démarrer 2025
La fédération des Cuma Île-de-France a organisé son assemblée générale jeudi 20 février à Lumigny (Seine-et-Marne).
La fédération des Cuma Île-de-France a organisé son assemblée générale jeudi 20 février à Lumigny (Seine-et-Marne).

La fédération des Cuma Île-de-France a tenu son assemblée générale jeudi 20 février à Lumigny (Seine-et-Marne). La réunion s'est tenue à l'hôtel du Royaume des Lions, à deux pas de la réserve animalière. Nul besoin de jeter un ou deux participants aux fauves : le consensus était de mise en cette journée exceptionnellement ensoleillée, au moins en partie. D'un point de vue statutaire, il s'agissait notamment de modifier les statuts pour fixer le siège social au Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne) et de modifier la date de clôture comptable. L'assemblée générale avait été fixée en ce mois de février plutôt qu'à l'été, comme il en était coutume, pour éviter un trop grand absentéisme d'adhérents mobilisés dans les champs.
« Deux métiers »
En introduction, Vincent Boddaert a rappelé les « deux métiers » de la FRCuma Île-de-France : « Fournir des services aux Cuma adhérentes et défendre syndicalement le statut des Cuma, un outil conçu pour ceux qui veulent travailler en groupe mais qui, si on cesse de s'en occuper, peut devenir obsolète ». Le rapport d'activité et les comptes ont ensuite été présentés par Mathieu Teixeira, conseiller de la fédération Cuma du Loiret. Cette dernière est en effet liée par une convention avec la FRCuma pour une mise à disposition partielle de l'équipe technique loirétaine. Pour l'exercice précédent, un certain nombre de rattrapages de retards d'indemnisation et d'apurements de factures ont été menés pour aboutir à une situation « saine ».
Parmi les projets pour l'année 2025, se trouve la volonté d'augmenter le nombre d'adhérents. À ce jour, 66 Cuma sont adhérentes sur 84 recensées. « C'est un chiffre stable qui cache des mouvements de sorties, mais aussi d'entrées. La région Île-de-France est un territoire où se créent encore des Cuma », souligne Mathieu Teixeira. Autre axe de travail important : l'amélioration de la circulation agricole. Cette problématique sera abordée d'abord en Seine-et-Marne avant d'être étendue à l'Île-de-France ouest. Avec la chambre d'Agriculture, le sujet des pneumatiques, qui avait commencé à être traité l'année dernière, sera poursuivi. Un guide sur les prix de revient sera élaboré. Enfin, pour répondre à un souhait des adhérents, une journée de démonstration de matériel devrait avoir lieu début août.
Les prix des matériels restent au cœur des préoccupations de nombreux adhérents. Vincent Boddaert est revenu sur les services proposés par la société Camacuma, auxquels la fédération souscrit. « Camacuma mutualise des achats agricoles (herses-étrilles, plateaux fourragers…) et propose de la location d’usage (tracteur, télescopique, mini-pelles…). Si l'assurance reste à la charge de la Cuma, l'avantage est qu'il n'y a pas de mauvaise surprise, les coûts sont connus et maîtrisés », a-t-il expliqué.
Avant une intervention sur les principes de la compensation collective (voir ci-dessous), Vincent Boddaert a exprimé le souhait qu'une délégation francilienne se forme pour participer au congrès national de la FNCuma, qui aura lieu cette année les 3, 4 et 5 juin à Beaune.
Zoom sur la compensation collective agricole
Lors de l'assemblée générale de la FRCuma Île-de-France, un temps a été consacré à la compensation collective agricole, un dispositif encore assez méconnu et peu utilisé.
L'hôtel du Royaume des lions, où s'est tenue l'assemblée générale de la FRCuma Île-de-France, a été érigé sur des terres agricoles. Une aide de 240 000 euros a été versée par l'aménageur à la Cuma de la Houssaye, en vertu du mécanisme de la compensation collective agricole. « Dans une année difficile, cela nous a permis d'acheter du matériel », souligne Vincent Boddaert, président de la Cuma.
« Il faut trois conditions cumulatives pour obtenir cette compensation, explique Emmanuelle Suzanne, chargée d'étude aménagement et urbanisme à la chambre d'Agriculture de région Île-de-France : la surface de terre agricole consommée doit être au minimum d'un hectare — c'est une spécificité francilienne — ; le projet doit faire l'objet d'une étude d'impact environnemental ; il doit être situé sur un espace affecté ou ayant connu une activité agricole dans les cinq dernières années (ou trois dernières années en zone AU, zone à urbaniser) ». L'indemnité vient compenser la perte de l'économie agricole, de l'amont à l'aval, d'un territoire.
L'aménageur, lorsqu'il construit un projet qui consomme des terres agricoles, a obligation de mettre en place ce dispositif, et donc de trouver une structure qui réponde aux différents critères d'attribution. La difficulté, c'est qu'il s'écoule souvent de longues années entre ce moment et la mise en route concrète des travaux, où les fonds sont débloqués. Entre-temps, les besoins de la structure concernée pourraient avoir grandement évolué.
L'AADI (Association agri développement Île-de-France) a pour mission de gérer les fonds issus de la compensation collective agricole et de recenser les projets collectifs de territoire qui pourraient être candidats. Mais des accords peuvent également s'établir directement entre aménageurs et candidats. « Dans ce cadre, les Cuma, en tant que structures collectives de territoire, sont des bénéficiaires idéaux », a souligné Juliette Devillers, cheffe de service à la DDT de Seine-et-Marne.
Un guide méthodologique de la compensation agricole collective a été publié sur le site de la Driaaf en septembre 2017. Il estime la valeur ajoutée moyenne d’un hectare agricole à plus de 17 000 euros.