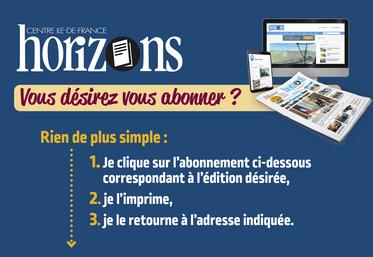Blé de force : quel avenir pour cette filière puissamment ancrée sur le territoire ?
L'Association générale des producteurs de blé (AGPB) a organisé une soirée-conférence mercredi 29 janvier à Amilly (Loiret) consacrée au blé de force.
L'Association générale des producteurs de blé (AGPB) a organisé une soirée-conférence mercredi 29 janvier à Amilly (Loiret) consacrée au blé de force.

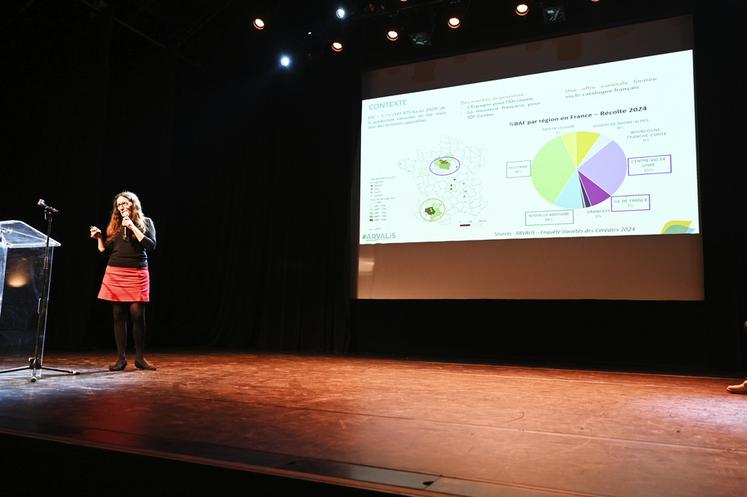


Très ancré sur le territoire, le blé de force, ou blé améliorant, a fait l'objet d'une conférence organisée mercredi 29 janvier par l'Association générale des producteurs de blé (AGPB) à Amilly (Loiret), à l'initiative de son administrateur local de l'étape, Cédric Benoist. À ses côtés, le secrétaire général adjoint, François Jacques, ainsi que trois intervenants experts, l'ingénieure agronome d'Arvalis Delphine Bouttet, le responsable de la filière blé des Moulins Soufflet, Fabrice Bourjot, et enfin Philippe Gate, membre de l'Académie d'agriculture de France.
« Depuis les premières variétés Courtot ou Galibier, le Loiret a fait partie des départements précurseurs où la culture du blé de force s'est installée durablement il y a cinquante ans, ont introduit Cédric Benoist et François Jacques. Ici, le terroir offre la possibilité de donner pleine existence et pleine puissance à cette culture à valeur ajoutée ».
L'offre variétale s'étoffe régulièrement
En charge du club BAF (Blé améliorant ou de force) Centre Île-de-France, Delphine Bouttet a d'abord détaillé les caractéristiques attendues avec « un taux de protéines supérieur à 14 % et une force boulangère au-delà de 350, contre 170 pour un blé panifiable ». Rentrent aussi en ligne de compte des caractéristiques liées à l'hydratation de la farine et sa stabilité. « La région Centre est la deuxième région de France la plus productrice de blé améliorant. Elle représente 25 % à elle seule et la totalité est destinée à la meunerie française ». Et l'ingénieure de poursuivre avec des propos encourageants sur le développement de la filière : « Les semenciers sont actifs sur cette filière, l'offre s'étoffe. Il y a eu plusieurs inscriptions ces dernières années avec des variétés intéressantes telles que Rebelde ou Forcali ».
En plus d'apporter rendements et protéines — deux notions normalement antagonistes —, ces nouvelles variétés apportent du progrès génétique avec une meilleure tolérance à la verse et une amélioration de la productivité de l'ordre de 0,6 q/h/an et des poids spécifiques toujours à la hauteur des attendus.
À la suite, Fabrice Bourjot a dressé le portrait d'une filière meunière en demande constante et progressive de ces blés principalement utilisés pour les viennoiseries (80 %), les pains de mie (30 %) et le pain classique (15 %) et surtout dans les filières de fabrication surgelée. « Ils représentent 20 % de nos besoins actuels contre 10 % il y a cinq ans, souligne-t-il. Les surfaces sont en hausse, et les primes filières sont désormais intéressantes après avoir connu une période baissière en 2020 ».
Agir sur l'apport azoté et le bilan carbone
Si la filière est aujourd'hui porteuse dans le département, reste la question de son avenir dans un contexte de pression réglementaire et économique contraint. L'académicien Philippe Gate a tenté d'apporter quelques pistes de réflexion. « L'idée étant de réduire les émissions de gaz à effet de serre en grandes cultures, il convient de regarder comment réduire les doses d'engrais. Le choix variétal génétique est indéniablement un des leviers majeurs, mais on peut aussi se pencher sur la présence de légumineuses dans la rotation ou en interculture, sur l'apport d'amendement organique ou encore sur l'usage des biostimulants ».
Et l'ancien directeur scientifique d'Arvalis de poursuivre : « L'élevage est fortement attaqué sur son bilan carbone, et le sujet arrive aussi pour les grandes cultures. Il ne s'agit pas d'être dans une logique de décroissance mais de s'adapter selon le contexte actuel en cherchant à augmenter la teneur en matière organique de nos sols. Sans hivers rigoureux, les sols travaillent moins et nous rencontrons des problèmes de structure ».
En fin de séquence, les experts ont alors débattu autour de l'usage de compost de déchets verts. Une piste qui reste à explorer pour apporter résilience et donc rentabilité dans les fermes productrices de blé de force.